Histoire de France au Moyen-Âge : le 18 Décembre. Le 18 décembre 1118, Baudouin Ier, roi de Jérusalem, meurt au cours...

Histoire de France au Moyen-Âge : le 31 Octobre
Histoire de France au Moyen-Âge : le 31 Octobre

31 octobre 1422 : La mort de Charles VI — La fin d’un règne tragique et la naissance de l’espoir capétien
Un roi au destin brisé
Le 31 octobre 1422, le roi Charles VI de France s’éteint à Paris, dans l’hôtel Saint-Pol, après quarante-deux années d’un règne tourmenté. Connu sous le nom de "Charles le Fou", il incarne l’un des souverains les plus tragiques du Moyen Âge français. Son règne, débuté dans l’espérance d’un royaume prospère, s’achève dans la division et la ruine. Les crises politiques, la guerre de Cent Ans et ses longues périodes de démence ont plongé la France dans le chaos. Pourtant, sa mort ouvre aussi une page nouvelle : celle de la lente résurrection du royaume sous son fils, le futur Charles VII.
Un début de règne prometteur
Fils de Charles V le Sage, Charles VI monte sur le trône à l’âge de onze ans. Sous la régence de ses oncles, notamment le duc de Bourgogne et le duc de Berry, le royaume reste puissant et organisé. Le jeune roi, une fois majeur, gouverne avec énergie. Les fêtes, les tournois et les armes capétiennes symbolisent alors la grandeur de la monarchie française. Mais dès 1392, lors d’une campagne contre le duc de Bretagne, Charles est frappé d’une violente crise de folie : il attaque ses propres soldats et tue plusieurs d’entre eux. Dès lors, le roi n’est plus que l’ombre de lui-même, et la France sombre dans l’instabilité.
Le royaume en guerre civile
Profitant de la faiblesse du roi, les grands du royaume s’affrontent pour le pouvoir. Les Armagnacs, partisans du dauphin Charles, s’opposent aux Bourguignons, alliés à l’Angleterre. Paris devient le théâtre de luttes sanglantes, tandis que les provinces tombent aux mains de l’ennemi. Les chevaliers, autrefois unis sous l’oriflamme royale, se divisent. On voit alors s’affronter des hommes d’armes portant les bannières du lys et du léopard, des armures brillantes mais opposées, et des épées tournées contre leurs frères d’armes. L’esprit chevaleresque du XIVᵉ siècle s’éteint dans la guerre civile.
Le traité de Troyes et l’humiliation française
En 1420, alors que Charles VI n’est plus que le jouet de ses conseillers, la reine Isabeau de Bavière conclut avec Henri V d’Angleterre le funeste traité de Troyes. Par cet accord, la couronne de France est promise au roi d’Angleterre, qui épouse leur fille, Catherine de Valois. Le dauphin Charles, légitime héritier, est déshérité et banni du royaume. L’humiliation est totale : les boucliers français sont mêlés aux armes anglaises, et Paris devient une cité sous domination étrangère. Quand Henri V meurt en 1422, son fils, le jeune Henri VI, est reconnu roi de France par le parti anglo-bourguignon, tandis que le dauphin se réfugie dans le sud.
La mort du roi
Affaibli, isolé et souvent inconscient, Charles VI meurt le 31 octobre 1422. Les témoins racontent qu’il expira dans la paix, entouré de quelques serviteurs restés fidèles. Son corps fut transporté à la basilique de Saint-Denis, escorté par des soldats portant les oriflammes royales et des épées capétiennes. Mais aucune cloche ne sonna à Paris, alors tenue par les Anglais : le roi de France mourut dans le silence de sa propre capitale. Ce silence résonne comme le symbole de l’effacement temporaire de la monarchie française.
La renaissance du royaume sous Charles VII
Pourtant, de cette nuit tragique allait naître l’espoir. Le dauphin Charles, héritier légitime, refuse d’abandonner ses droits. Avec l’aide de fidèles chevaliers et de héros anonymes, il prépare la reconquête. Vingt ans plus tard, grâce au courage de Jeanne d’Arc, la France se relèvera. Les armures françaises, les haches de guerre et les lances des chevaliers reprendront le combat pour restaurer le royaume.
Un règne maudit, une mémoire persistante
Charles VI demeure dans la mémoire nationale comme un roi malheureux, victime de la maladie et des ambitions des autres. Mais sous son règne, la France a aussi connu un âge d’art et de piété : les cathédrales, les manuscrits enluminés et les bijoux médiévaux de cour témoignent de la grandeur d’une époque tourmentée. Son épouse Isabeau de Bavière, malgré les critiques, maintint la cour et son éclat jusqu’à la fin. Le 31 octobre 1422 marque donc la mort d’un roi et la fin d’une ère, mais aussi le point de départ de la restauration capétienne menée par Charles VII.
Conclusion : la fin d’un monde, le début d’un autre
La mort de Charles VI scelle la disparition d’une France médiévale divisée et malade. Mais elle annonce aussi la renaissance du royaume, grâce au courage et à la foi d’un peuple qui ne renonce jamais. À travers les épées des chevaliers, les armures de bataille et les oriflammes royaux que perpétue La Forge des Chevaliers®, c’est toute la mémoire d’un royaume meurtri mais immortel qui continue de briller.
Histoire de France au Moyen-Âge : le 31 Octobre

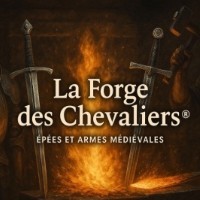
















Laisser un commentaire