Histoire de France au Moyen-Âge : le 18 Décembre. Le 18 décembre 1118, Baudouin Ier, roi de Jérusalem, meurt au cours...

Histoire de France au Moyen-Âge : le 20 Août
Histoire de France au Moyen-Âge : le 20 Août

20 août 1031 : Mort du roi Robert II le Pieux, premières secousses dans la dynastie capétienne
Un roi pieux et bâtisseur d’unité capétienne
Le 20 août 1031, Robert II meurt à Melun après trente-cinq années de règne. Fils d’Hugues Capet, il est le deuxième roi de la dynastie capétienne, fondée en 987. Surnommé « le Pieux », il s’investit profondément dans les affaires ecclésiastiques, fonde des abbayes, restaure l’autorité royale sur certaines terres et s’efforce d’étendre l’influence capétienne au-delà de l’Île-de-France.
Une succession difficile et un royaume fragilisé
À sa mort, son fils Henri Ier lui succède, mais la transmission du pouvoir ne se fait pas sans heurts. Le frère cadet, Robert, réclame une part du royaume, soutenu par de grands vassaux. Cette rivalité dégénère en conflit ouvert. Henri Ier doit affronter une coalition menée par son propre frère. Cette situation annonce les nombreuses crises de succession qui marqueront la dynastie.
Le pouvoir capétien encore fragile
En 1031, la monarchie française est encore jeune et son autorité limitée. Les grands seigneurs – ducs de Normandie, comtes de Blois, d’Anjou ou de Champagne – disposent de forces armées puissantes, de châteaux fortifiés et d’armements raffinés. Les armes et équipements représentatifs de cette époque sont aujourd’hui disponibles chez La Forge des Chevaliers® :
Un roi entre foi et politique
Robert II fut un monarque très pieux, entouré d’ecclésiastiques comme l’évêque Gerbert d’Aurillac (futur pape Sylvestre II). Il encourage la réforme monastique, soutient Cluny et impose la Trêve de Dieu. Mais sa piété ne l’empêche pas d’agir politiquement, notamment en mariant ses enfants selon des stratégies d’alliances territoriales.
Une cour royale en quête de légitimité
La cour capétienne du début du XIᵉ siècle tente d’imposer un nouveau modèle de royauté, sacré mais actif, pieux mais guerrier. Les objets symboliques tels que les couronnes, sceptres, épées et bannières prennent une importance croissante. Ils s’inscrivent dans un imaginaire de continuité carolingienne que l’on retrouve dans les reconstitutions disponibles chez La Forge des Chevaliers® :
Les funérailles de Robert II et la mise en scène du pouvoir
Robert II est inhumé à Saint-Denis, comme son père Hugues Capet. La cérémonie funèbre est l’occasion d’une mise en scène de la continuité dynastique. Les bannières, les oriflammes et les épées cérémonielles sont portées lors du cortège. Cette pratique deviendra une constante dans les enterrements royaux français.
Conséquences politiques immédiates
À peine enterré, le royaume se divise. Henri Ier doit céder le duché de Bourgogne à son frère pour apaiser le conflit. Cette concession affaiblit la Couronne mais assure une paix temporaire. Elle illustre les limites du pouvoir royal face à l’autonomie des grands féodaux, dont les forteresses, armées et symboles héraldiques rivalisent avec ceux du roi.
Conclusion : 20 août 1031, les fragilités d’une monarchie naissante
La mort de Robert II le Pieux marque la fin d’un règne de stabilité relative et le début d’un siècle de luttes successorales. La dynastie capétienne, encore jeune, doit affronter les ambitions des grands vassaux. Ce moment fondateur, entre sacré et stratégie, se reflète dans les objets d’époque reproduits par La Forge des Chevaliers®, témoins de la naissance d’un royaume encore en devenir.
Histoire de France au Moyen-Âge : le 20 Août

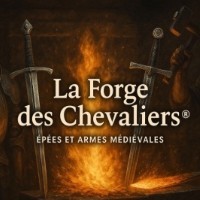
















Laisser un commentaire