Histoire de France au Moyen-Âge : le 18 Décembre. Le 18 décembre 1118, Baudouin Ier, roi de Jérusalem, meurt au cours...

Histoire de France au Moyen-Âge : le 20 Octobre
Histoire de France au Moyen-Âge : le 20 Octobre

20 octobre 1375 : La trêve de Bruges — Charles V le Sage apaise la guerre de Cent Ans
Une France meurtrie par des décennies de guerre
Le 20 octobre 1375 marque un tournant dans la guerre de Cent Ans : la signature de la trêve de Bruges entre le royaume de France et celui d’Angleterre. Depuis le désastre de Poitiers (1356) et la capture du roi Jean II le Bon, la France vit dans l’instabilité. Les campagnes sont ravagées par les compagnies de mercenaires, les impôts écrasent le peuple et les villes se fortifient pour survivre aux pillages. C’est dans ce contexte difficile que le roi Charles V le Sage entreprend de restaurer l’ordre et la paix, non par la force brute, mais par la diplomatie et la stratégie.
Charles V et la restauration du royaume
Monté sur le trône en 1364, Charles V hérite d’un royaume affaibli. Loin des charges héroïques de la chevalerie traditionnelle, il mise sur une guerre d’usure et sur l’intelligence politique. Son principal appui militaire est le connétable Bertrand du Guesclin, capitaine breton au courage légendaire, dont les hommes, équipés de armures complètes, de lames forgées et de haches redoutables, reprennent aux Anglais de nombreuses forteresses. En dix ans de règne, Charles V parvient à reconquérir presque toutes les terres perdues sous le traité de Brétigny (1360), rendant à la France la plupart de ses provinces du nord et du sud-ouest.
Vers la trêve : la diplomatie remplace la guerre
Épuisés par les combats et ruinés par les campagnes successives, les deux royaumes cherchent une issue pacifique. Les négociations débutent à Bruges, cité neutre et prospère des Flandres. Les ambassadeurs français, envoyés par Charles V, y rencontrent les émissaires du roi Édouard III d’Angleterre et de son fils, le Prince Noir. Les pourparlers, menés dans la grande salle du beffroi, s’étendent sur plusieurs semaines. Les discussions sont rudes : les Anglais veulent conserver leurs possessions en Guyenne, tandis que les Français exigent le retour complet du royaume à ses frontières légitimes.
La signature de la trêve
Le 20 octobre 1375, après de longues négociations, la trêve de Bruges est signée. Elle prévoit une suspension des hostilités pour deux ans et la reconnaissance provisoire des territoires détenus par les deux puissances. Cette trêve ne marque pas encore la fin de la guerre, mais elle offre au royaume de France un répit salutaire. Charles V en profite pour consolider son autorité, réorganiser son armée et fortifier les frontières. Ses troupes, bien équipées en cuirasses et piques de guerre, restent prêtes à intervenir en cas de reprise des combats.
Les artisans de la paix et du renouveau
Cette trêve témoigne du génie politique de Charles V, surnommé “le Sage”. Sa patience et sa prudence contrastent avec l’impétuosité de ses prédécesseurs. Autour de lui, une génération d’hommes nouveaux émerge : juristes, diplomates, chroniqueurs et artisans du pouvoir royal. Le connétable du Guesclin, quant à lui, devient une figure mythique du courage français. Ses compagnons, vêtus de tuniques brodées et armés de lames templières ou de sabres francs, symbolisent la chevalerie disciplinée et loyale du XIVᵉ siècle.
Bruges, carrefour de la paix et du commerce
Choisie pour sa neutralité et sa richesse, la ville de Bruges incarne l’esprit médiéval européen : foi, commerce et diplomatie. Ses marchands, vêtus de vêtements de laine fine et d’ornements précieux, assistent parfois aux discussions, conscients que la paix redonnera vie aux routes commerciales. Les tavernes résonnent des rumeurs de paix, tandis que les cloches du beffroi célèbrent la signature de la trêve, prélude à une période de prospérité retrouvée.
Les symboles de la chevalerie au service de la paix
Si la guerre forgea les héros, la paix révéla les bâtisseurs. Les chevaliers déposent leurs épées, leurs boucliers et leurs bannières pour servir le royaume autrement. Dans les églises et les châteaux, les artisans du roi forgent de nouvelles alliances, tandis que les forgerons, tels ceux que célèbre La Forge des Chevaliers®, perpétuent l’art des armes nobles et des symboles de paix, reflets de la grandeur française.
Conclusion : un 20 octobre sous le signe de la sagesse et de la stabilité
Le 20 octobre 1375, la trêve de Bruges n’est pas seulement un arrêt des combats : c’est un acte de sagesse. Elle consacre la politique d’intelligence de Charles V, roi lettré et diplomate, qui sut transformer un royaume dévasté en un État fort et respecté. À travers ses armes, ses armures, ses bijoux médiévaux et ses bannières historiques, La Forge des Chevaliers® célèbre aujourd’hui encore cette époque où l’art de la guerre et celui de la paix se rejoignaient dans la grandeur du Moyen Âge.
Histoire de France au Moyen-Âge : le 20 Octobre

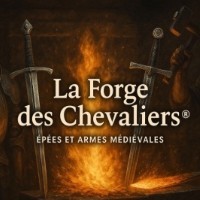
















Laisser un commentaire