Histoire de France au Moyen-Âge : le 18 Décembre. Le 18 décembre 1118, Baudouin Ier, roi de Jérusalem, meurt au cours...

Histoire de France au Moyen-Âge : le 25 Octobre
Histoire de France au Moyen-Âge : le 25 Octobre

25 octobre 1415 : La bataille d’Azincourt — La gloire brisée de la chevalerie française
Une France affaiblie par la guerre civile
Le 25 octobre 1415, veille de la fête de la Saint-Crépin, la chevalerie française subit l’une des plus terribles défaites de son histoire : la bataille d’Azincourt. Depuis des années, le royaume de France est ravagé par la guerre de Cent Ans et miné par la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. Le roi Charles VI, frappé de crises de folie, ne peut assurer le commandement. C’est donc une noblesse divisée et désordonnée qui fait face à l’armée d’Henri V d’Angleterre, roi jeune, habile et discipliné.
Deux armées inégales face à face
Henri V, parti d’Angleterre à la tête d’environ 6 000 hommes, débarque en Normandie à l’été 1415. Après la longue prise d’Harfleur, son armée affaiblie tente de rejoindre Calais pour regagner l’Angleterre. Mais les Français, rassemblant près de 20 000 hommes, lui coupent la route à proximité du petit village d’Azincourt, dans l’Artois. Les chevaliers français, couverts de cuirasses de plates, portant de larges boucliers héraldique et des épées longues, font face à des archers anglais agiles, armés d’arcs longs redoutables. La confiance excessive des nobles français contraste avec la rigueur tactique d’Henri V, dont les hommes creusent des fossés défensifs et dressent des pieux pour protéger leurs lignes.
Un champ de bataille devenu piège
À l’aube du 25 octobre 1415, la pluie s’abat sur les plaines boueuses d’Azincourt. Le sol détrempé transforme le champ de bataille en bourbier. Lorsque la cavalerie française charge, les chevaux s’enlisent, les fantassins s’écrasent les uns sur les autres et les archers anglais profitent de la confusion. Les traits des arcs, tirés avec une cadence meurtrière, transpercent les heaumes et les écus. Les masses d’armes et dagues achèvent les chevaliers à terre. La fierté de la chevalerie française, engoncée dans son armure, devient sa perte.
Une hécatombe parmi la noblesse française
En quelques heures, c’est un désastre total. Plus de 7 000 Français trouvent la mort, parmi eux de grands seigneurs : le duc d’Alençon, le comte de Vaudemont, le duc de Brabant, le connétable Charles d’Albret… La fleur de la noblesse française gît dans la boue. Henri V, bien que victorieux, est lui-même horrifié par l’ampleur du massacre. Il fait grâce à quelques captifs de haut rang, mais ordonne l’exécution de nombreux prisonniers, craignant une contre-attaque française. Les oriflammes du royaume de France tombent dans la fange, symbole d’une gloire perdue.
Les causes de la défaite
Les historiens du Moyen Âge s’accordent à voir dans Azincourt l’illustration d’une chevalerie trop attachée au prestige et à la bravoure individuelle. Les Français, mal commandés, attaquent en terrain défavorable sans stratégie d’ensemble. Les Anglais, eux, utilisent le terrain, la discipline et la puissance de l’archerie pour vaincre une armée pourtant trois fois plus nombreuse. Cette défaite humiliante révèle la nécessité d’une réforme militaire en profondeur, qui ne prendra forme que sous Charles VII avec l’organisation d’une armée permanente et l’usage combiné de l’infanterie et de la cavalerie légère.
Le courage malgré la défaite
Si la défaite d’Azincourt marque un deuil national, elle n’efface pas le courage des chevaliers français. Beaucoup se battent jusqu’à la mort, défendant leur honneur plus que leur vie. Leurs épées de chevaliers, armures complètes et boucliers ornés témoignent encore aujourd’hui de la noblesse de leur idéal. Certains survivants relatent les derniers instants de camarades tombés en invoquant le nom du roi et de saint Michel, protecteur de la France.
Azincourt, miroir d’une époque
La bataille d’Azincourt n’est pas seulement une défaite militaire ; elle incarne la fin d’un âge héroïque. Le modèle du chevalier isolé, combattant pour sa gloire, cède peu à peu la place à celui du soldat discipliné, au service de la nation. Les chroniques du Moyen Âge décrivent cette journée comme un avertissement du destin : sans unité, sans discipline, même les plus braves tombent. Les armes médiévales et bannières de France, restaurées et préservées aujourd’hui par La Forge des Chevaliers®, perpétuent le souvenir de ces héros tombés à Azincourt.
Conclusion : un 25 octobre sous le signe du sacrifice et de la mémoire
Le 25 octobre 1415 reste gravé dans la mémoire nationale comme le jour où la chevalerie française connut son Golgotha. Mais de cette défaite naîtra une renaissance : l’émergence d’une armée royale moderne et d’un patriotisme nouveau. De la hache de guerre du soldat à l’armure du chevalier, chaque objet de la collection de La Forge des Chevaliers® fait revivre l’esprit d’Azincourt : la foi, le courage et l’honneur, même dans la défaite.
Un autre évènement moins connu a eu lieu un 25 Octobre :
25 octobre 912 : Mort du roi Rodolphe Ier de Bourgogne — Le fondateur du royaume du Jura
La Bourgogne au cœur du Haut Moyen Âge
Le 25 octobre 912 marque la mort de Rodolphe Ier de Bourgogne, roi du royaume de Bourgogne transjurane, également appelé royaume du Jura. À la charnière du IXᵉ et du Xᵉ siècle, l’Europe occidentale est en pleine recomposition après l’effondrement de l’Empire carolingien. La Bourgogne, vaste région s’étendant des Alpes au Rhône, se retrouve partagée entre plusieurs principautés. C’est dans ce contexte que Rodolphe, issu d’une puissante famille d’origine alémanique, fonde un royaume indépendant, héritier à la fois de la tradition franque et de l’identité alpine.
Un roi issu de la noblesse carolingienne
Rodolphe Ier est le fils de Conrad II, comte d’Auxerre, et de Waldrade, apparentée à la noblesse carolingienne. Guerrier habile, il se distingue dès sa jeunesse dans les luttes territoriales qui secouent l’ancien royaume de Lothaire. Vers 888, il profite de la faiblesse de ses voisins pour se faire couronner roi de Bourgogne transjurane à Saint-Maurice d’Agaune, l’un des sanctuaires les plus anciens de la chrétienté occidentale. Ce sacre, entouré de prêtres en chapes et de chevaliers en armures, symbolise la continuité du pouvoir royal à travers la foi et la légitimité sacrée.
Le royaume du Jura : un bastion entre France et Empire
Le royaume fondé par Rodolphe Ier s’étend sur les terres qui correspondent aujourd’hui à la Suisse romande, à la Franche-Comté et à une partie de la Savoie. Situé entre le royaume de France occidentale et le Saint-Empire naissant, il joue un rôle diplomatique essentiel. Les seigneurs bourguignons, reconnaissables à leurs boucliers décorés et à leurs épées franques, défendent un territoire montagneux difficile d’accès mais stratégiquement vital pour le commerce entre l’Italie et le nord de l’Europe. Rodolphe, fin politique, consolide son autorité en s’appuyant sur l’Église et les alliances matrimoniales, plutôt que sur la seule guerre.
Un règne de consolidation et de diplomatie
Rodolphe Ier n’est pas seulement un roi guerrier, mais aussi un souverain bâtisseur. Il renforce les monastères, réorganise les domaines ecclésiastiques et encourage la fondation d’abbayes fortifiées. Ces lieux de prière et de défense, souvent protégés par des milices en lances d’hast et haches carolingiennes, incarnent le double visage du pouvoir royal médiéval : spirituel et martial. Sous son règne, la Bourgogne transjurane devient un modèle de stabilité au cœur d’une Europe morcelée.
Sa mort et la succession de Rodolphe II
Le 25 octobre 912, Rodolphe Ier meurt après vingt-quatre années de règne. Il laisse derrière lui un royaume solide et respecté, confié à son fils Rodolphe II, qui poursuivra son œuvre politique et diplomatique. Les chroniques racontent que ses funérailles furent célébrées dans l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, où les moines chantèrent le Requiem aeternam sous les voûtes romanes. Son cercueil, recouvert d’un drap d’armes brodé de croix, fut accompagné par des chevaliers tenant leurs épées pointées vers le sol, symbole du deuil royal.
L’héritage du royaume de Bourgogne
Le royaume de Rodolphe Ier survivra à son fondateur et deviendra, au fil des siècles, un carrefour culturel et politique majeur. De son union avec les royaumes voisins naîtra le futur royaume d’Arles, intégré au Saint-Empire au XIᵉ siècle. L’héritage bourguignon s’exprimera dans l’art de la chevalerie, les armes et la mode médiévale. Les bijoux médiévaux, les vêtements de cour et les armures de chevaliers inspirés de cette époque perpétuent la mémoire d’un royaume à la fois franc, alpin et spirituel.
Conclusion : un 25 octobre sous le signe de la sagesse et de la foi
La mort de Rodolphe Ier de Bourgogne, le 25 octobre 912, marque la disparition d’un roi fondateur et visionnaire. Son règne, empreint de sagesse et de dévotion, illustre la capacité des souverains du Haut Moyen Âge à unir la foi, la justice et la force des armes. Son héritage se retrouve dans les armes des Carolingiens, les étendards royaux et les armures de chevaliers que préserve La Forge des Chevaliers®, gardienne fidèle de la grandeur des rois oubliés du Moyen Âge.
Histoire de France au Moyen-Âge : le 25 Octobre

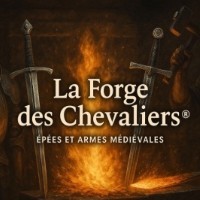
















Laisser un commentaire