Histoire de France au Moyen-Âge : 4 janvier. Le 4 janvier 1378, Paris vit un moment rare : l’empereur Charles IV...

Histoire de France au Moyen-Âge : le 20 Septembre
Histoire de France au Moyen-Âge : le 20 Septembre

20 septembre 1435 : Signature du traité d’Arras — La réconciliation entre Charles VII et le duc de Bourgogne
Un royaume encore divisé après des décennies de guerre
En 1435, la guerre de Cent Ans dure depuis près d’un siècle. La France est profondément déchirée : au nord, les troupes anglaises contrôlent encore la Normandie et une partie de l’Île-de-France ; à l’est, la puissante maison de Bourgogne s’est longtemps alliée à l’Angleterre. Depuis l’assassinat de Jean sans Peur en 1419, la rupture entre le roi Charles VII et les ducs de Bourgogne semblait irréparable. Le traité de Troyes (1420), qui déshéritait le dauphin au profit du roi d’Angleterre, avait aggravé ce conflit interne. Pourtant, la résistance française, relancée par l’épopée de Jeanne d’Arc (1429), commence à renverser l’équilibre.
Un contexte diplomatique décisif
Après les succès militaires français, notamment la levée du siège d’Orléans et le sacre de Reims, Charles VII cherche à isoler l’Angleterre. Il comprend que la réconciliation avec la Bourgogne est la clé pour restaurer l’unité du royaume. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, de son côté, souhaite sécuriser ses possessions et mettre fin à une guerre ruineuse pour ses finances et ses villes flamandes. Ces intérêts convergents ouvrent la voie à une négociation majeure.
Arras, un lieu de rencontre stratégique
La ville d’Arras, riche cité des Flandres, est choisie comme cadre de la rencontre. Les négociations, menées avec le soutien du pape Eugène IV et du concile de Bâle, durent plusieurs semaines. Les plénipotentiaires de Charles VII et de Philippe le Bon débattent des conditions d’une paix qui doit redéfinir l’équilibre politique du royaume de France.
Le 20 septembre 1435 : un traité fondateur
Le 20 septembre, les deux parties signent le traité d’Arras. Par cet accord, Charles VII reconnaît l’indépendance de fait du duché de Bourgogne et concède d’importants avantages territoriaux : le comté d’Auxerre, les villes de la Somme (Péronne, Roye, Montdidier, Saint-Quentin) et diverses terres picardes. En contrepartie, Philippe le Bon rompt son alliance avec l’Angleterre, reconnaît Charles VII comme roi légitime et promet de ne plus soutenir les Anglais.
Les clauses politiques du traité
Le traité comporte aussi des dispositions de réconciliation dynastique. Charles VII exprime officiellement son regret pour l’assassinat de Jean sans Peur en 1419. Cet acte de contrition, loin d’être purement symbolique, scelle la fin de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons qui avait saigné le royaume pendant des décennies. Pour la monarchie française, c’est une victoire diplomatique décisive.
Les conséquences militaires et stratégiques
En privant l’Angleterre de l’appui bourguignon, le traité d’Arras affaiblit considérablement la position anglaise en France. Les troupes de Charles VII peuvent désormais concentrer leurs efforts sur la reconquête des territoires occupés. Cette réconciliation ouvre la voie à une série de campagnes victorieuses qui aboutiront, quelques années plus tard, à l’expulsion presque totale des Anglais du royaume.
Les armes et l’art militaire du XVe siècle
La période autour de 1435 est marquée par une évolution de l’armement et des tactiques. Les chevaliers portent des armures de plates complètes, manient des épées longues, des lances, des arbalètes et de nouvelles armes de siège. Les amateurs de reconstitution historique retrouveront ces équipements dans les collections de La Forge des Chevaliers®, ou parmi les armes d’inspiration Chevaleresque, parfaites pour illustrer l’univers militaire de la fin de la guerre de Cent Ans.
Une victoire diplomatique pour Charles VII
Grâce au traité d’Arras, Charles VII renforce considérablement son autorité. Il parvient à rallier une des plus puissantes principautés du royaume sans avoir à livrer une grande bataille. Ce succès diplomatique illustre une stratégie patiente, commencée après les exploits de Jeanne d’Arc, pour pacifier le royaume avant de le reconquérir. L’habileté politique du roi lui vaudra plus tard le surnom de “roi restaurateur de la France”.
La mémoire du traité d’Arras
Dans l’histoire de France, le 20 septembre 1435 symbolise la fin d’un schisme politique qui avait fragilisé le pays depuis près de vingt ans. La réconciliation entre le roi et le duc de Bourgogne prépare le terrain pour la fin de la guerre de Cent Ans. Elle marque aussi une étape dans l’affirmation d’un État centralisé, capable de surmonter les rivalités féodales au profit de l’intérêt national.
Conclusion : un 20 septembre fondateur pour l’unité du royaume
Le traité d’Arras du 20 septembre 1435 ne se limite pas à un accord territorial. Il représente une victoire de la diplomatie sur la guerre civile, un moment où la France, meurtrie par un siècle de conflits, amorce son redressement. Grâce à cette réconciliation, Charles VII peut concentrer ses forces contre l’Angleterre et préparer la reconquête qui aboutira, quelques années plus tard, à la libération quasi totale du royaume. C’est une étape clé dans l’histoire médiévale française et un modèle d’équilibre entre fermeté militaire et habileté politique.
Histoire de France au Moyen-Âge : le 20 Septembre

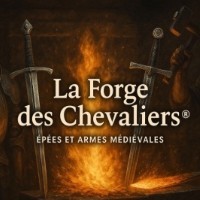




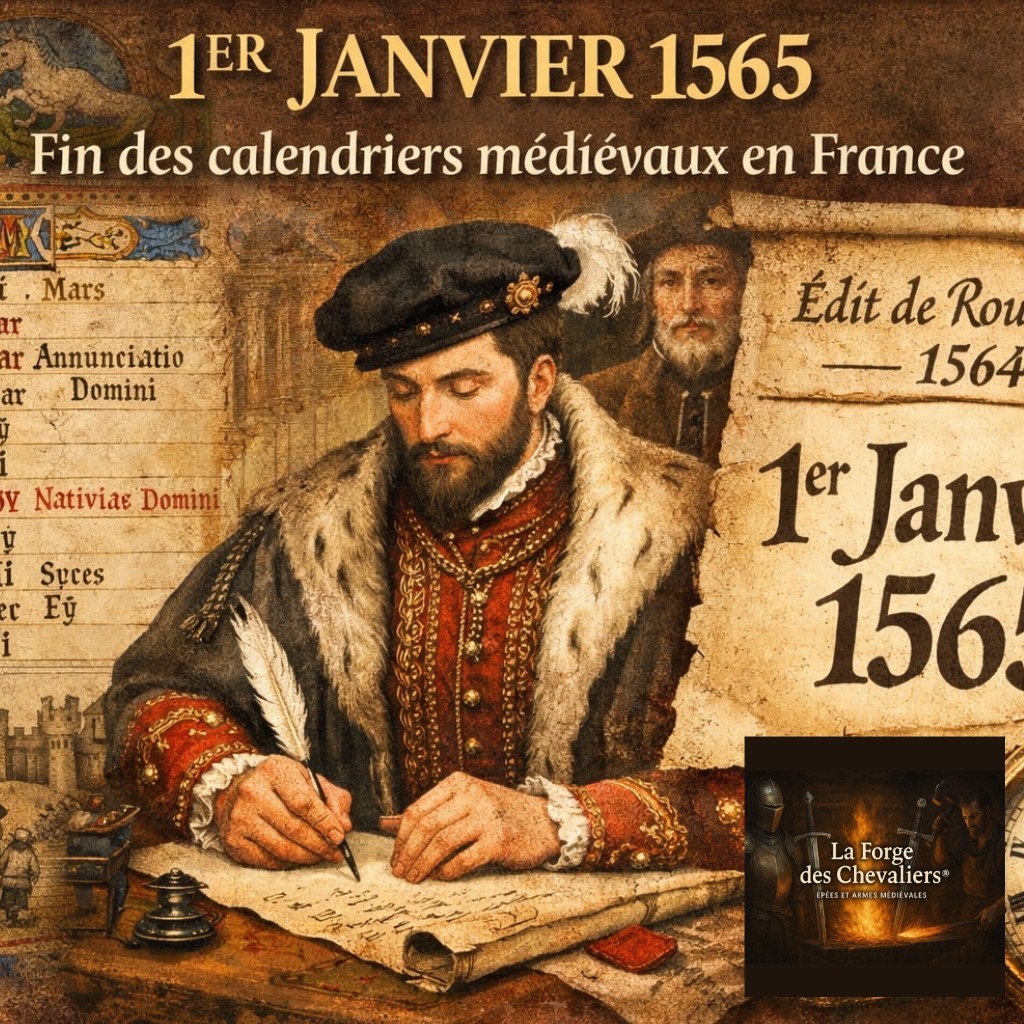


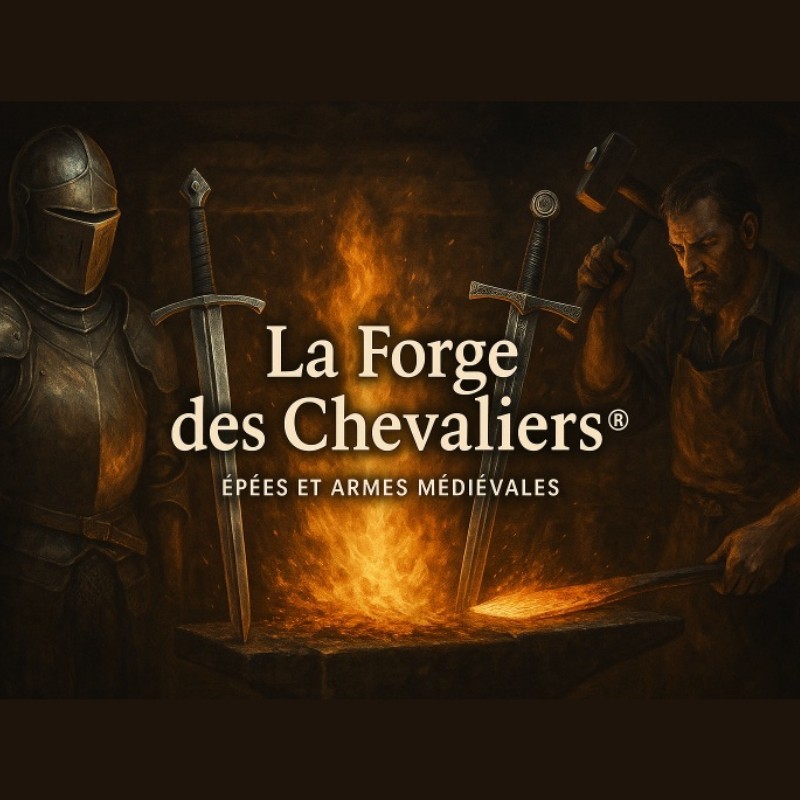
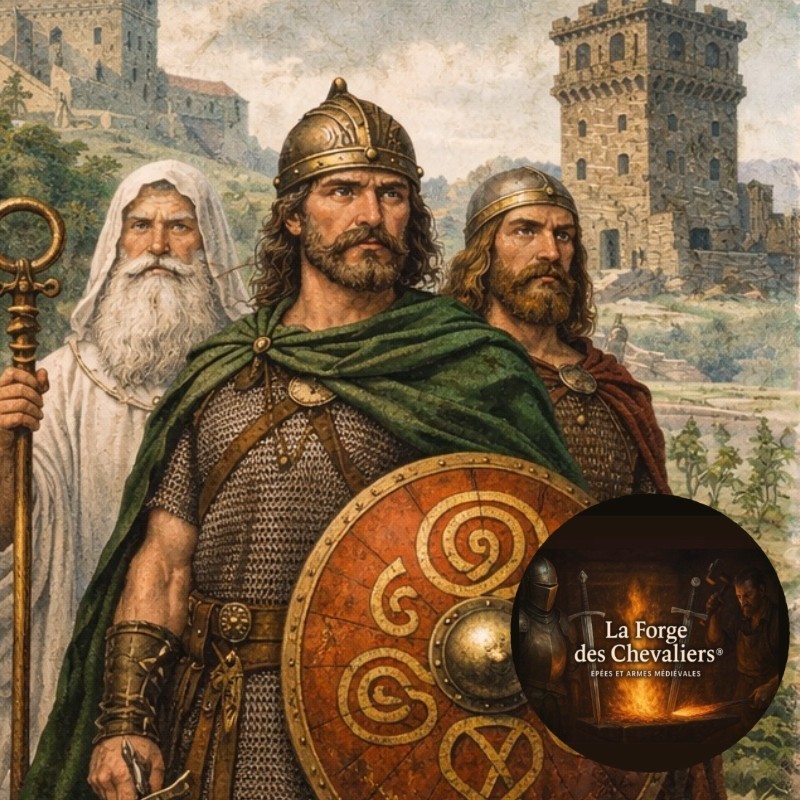







Laisser un commentaire