Histoire de France au Moyen-Âge : 4 janvier. Le 4 janvier 1378, Paris vit un moment rare : l’empereur Charles IV...

Histoire de France au Moyen-Âge : le 28 Septembre
Histoire de France au Moyen-Âge : le 28 Septembre
28 septembre 1347 : La trêve de Calais — Un répit fragile dans la guerre de Cent Ans
Le contexte : un royaume épuisé par la guerre
Au milieu du XIVe siècle, la France et l’Angleterre s’affrontent depuis plus de dix ans dans une guerre aux origines dynastiques et économiques. La guerre de Cent Ans, commencée en 1337, oppose le roi de France Philippe VI de Valois à Édouard III d’Angleterre, qui revendique la couronne française en raison de son ascendance capétienne. Après la désastreuse défaite française de Crécy en 1346, le royaume est en crise. Les campagnes sont ravagées, les finances exsangues et les grandes villes, terrorisées par les armées en marche.
Le siège de Calais : une épreuve d’un an
En septembre 1346, Édouard III, victorieux à Crécy, met le siège devant Calais, cité portuaire essentielle pour le contrôle du détroit. La ville, fortifiée et bien défendue, résiste héroïquement pendant près d’un an. Les Anglais, solidement retranchés, coupent l’approvisionnement par terre et par mer. La population, affamée, subit des souffrances extrêmes. Malgré plusieurs tentatives françaises pour briser le siège, Philippe VI échoue à libérer la ville.
La reddition de Calais et le célèbre épisode des bourgeois
Le 3 août 1347, les habitants de Calais, à bout de forces, se rendent à Édouard III. Selon la chronique de Jean Froissart, six notables de la ville — les “bourgeois de Calais” — se présentent pieds nus, la corde au cou, pour remettre les clés de la cité au roi d’Angleterre. Leur courage émeut la reine Philippa de Hainaut, qui obtient leur grâce. Cet épisode devient l’un des symboles les plus marquants de la guerre médiévale et de la bravoure urbaine face à l’envahisseur.
Les négociations de la trêve
Après la prise de Calais, Édouard III installe des colons anglais dans la ville et la transforme en base stratégique pour de futures opérations en France. Mais les deux royaumes sont épuisés. La guerre, la peste et les famines déciment les populations. À la demande du pape Clément VI, des négociations sont engagées entre les deux souverains.
Le 28 septembre 1347, la **trêve de Calais** est signée. Elle met fin temporairement aux hostilités et instaure un fragile équilibre entre les deux puissances. Cette trêve, censée durer neuf mois, sera prolongée à plusieurs reprises, permettant une accalmie relative jusqu’en 1355.
Les clauses de la trêve
Le traité prévoit la cessation des combats sur l’ensemble du royaume, la restitution de certains prisonniers et la confirmation des possessions anglaises déjà conquises, notamment Calais. En contrepartie, Philippe VI conserve la reconnaissance de sa souveraineté sur le reste du territoire. Les deux monarques promettent également de ne plus attaquer les alliés respectifs durant la durée de la trêve. En réalité, les escarmouches persistent dans les zones frontalières et sur mer.
Les conséquences immédiates
Pour Édouard III, la trêve est un succès politique : elle légitime ses conquêtes et lui permet de consolider sa domination sur le nord de la France. Pour Philippe VI, elle représente un répit nécessaire, lui offrant le temps de réorganiser ses finances et de rétablir son autorité affaiblie. Mais cette paix relative n’est qu’illusoire : les tensions restent vives et les ambitions anglaises inchangées.
Les armes et l’art de la guerre en 1347
La guerre de Cent Ans est aussi une révolution militaire. À Crécy et à Calais, les archers anglais armés du longbow surpassent la chevalerie française. Les chevaliers français, bien que courageux, peinent à s’adapter à ces nouvelles tactiques. Les armures complètes en acier, les épées longues et les masses d’armes utilisées à cette époque rappellent la splendeur guerrière du XIVe siècle. Ces armes emblématiques sont reproduites avec fidélité dans la collection Épées et Armes et dans les sections Haches et Masses et Armures médiévales de La Forge des Chevaliers®.
Un répit avant la tempête
Malgré la signature de la trêve, les causes profondes du conflit demeurent : rivalités dynastiques, contrôle des Flandres et des voies maritimes, et crise de succession. Les hostilités reprendront dès 1355, marquées par de nouveaux désastres pour la chevalerie française, notamment à Poitiers en 1356. La trêve de Calais n’aura donc été qu’un sursis dans une guerre qui s’étendra sur plus d’un siècle.
Le souvenir de Calais dans l’histoire
Calais restera anglaise pendant plus de deux siècles, jusqu’à sa reconquête par les troupes françaises de François de Guise en 1558. La ville portuaire gardera la mémoire de ces événements, notamment à travers le célèbre groupe sculpté “Les Bourgeois de Calais” d’Auguste Rodin, hommage à la bravoure de ses habitants. Pour les passionnés d’histoire médiévale, cet épisode incarne la grandeur tragique du XIVe siècle, entre honneur chevaleresque et diplomatie des trêves fragiles.
Conclusion : un 28 septembre entre guerre et paix
Le 28 septembre 1347, la signature de la trêve de Calais met fin à une campagne sanglante et ouvre une parenthèse de paix précaire. Cet accord, arraché à la lassitude des peuples, symbolise l’équilibre instable entre la guerre et la diplomatie au Moyen Âge. Entre le courage des chevaliers, la souffrance des cités assiégées et la volonté des rois de préserver leur honneur, ce 28 septembre reste l’un des moments charnières où la France, affaiblie mais résolue, prépare sa longue reconquête face à l’Angleterre.
Histoire de France au Moyen-Âge : le 28 Septembre

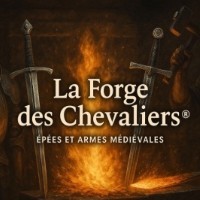




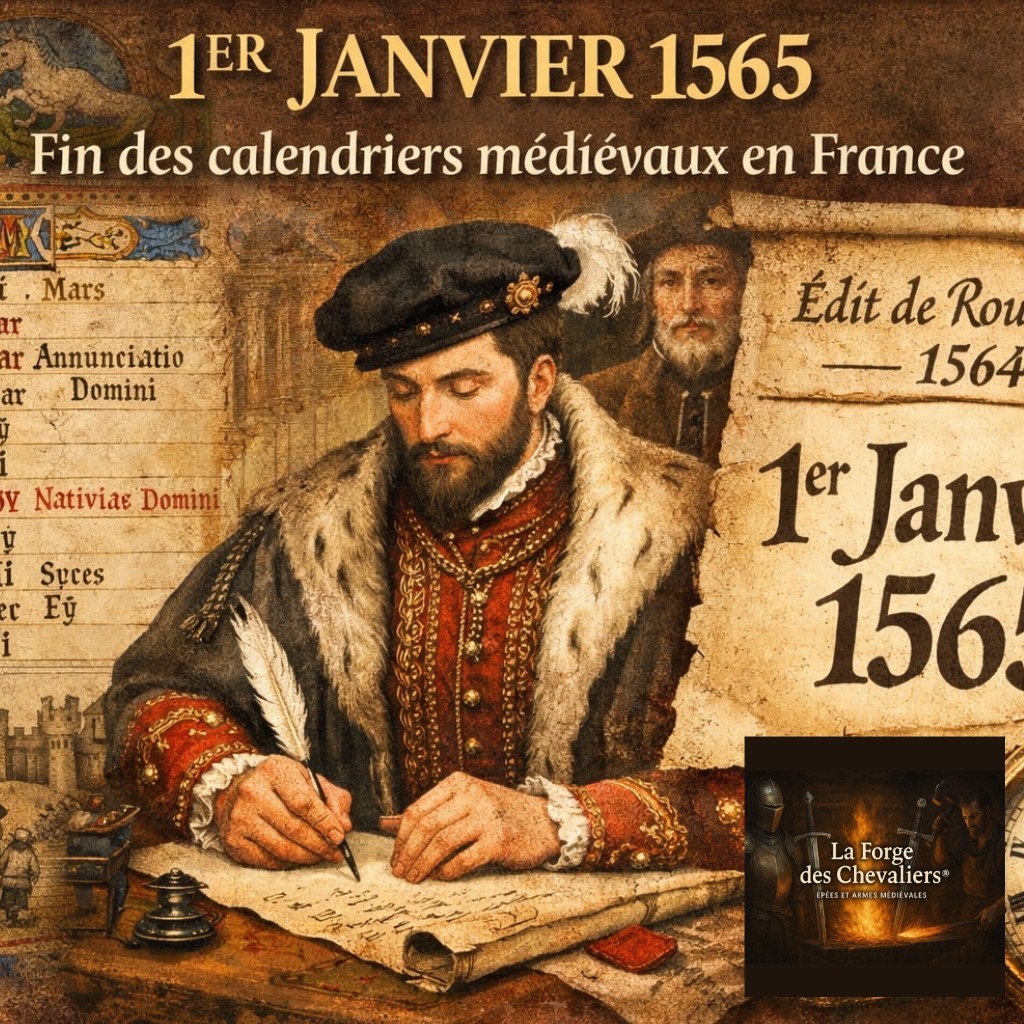


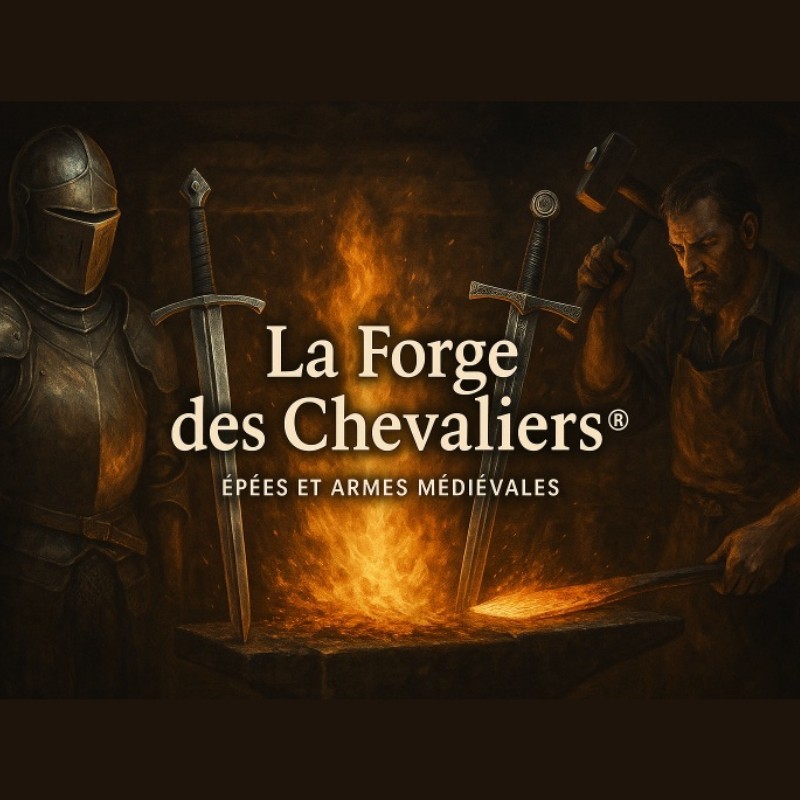
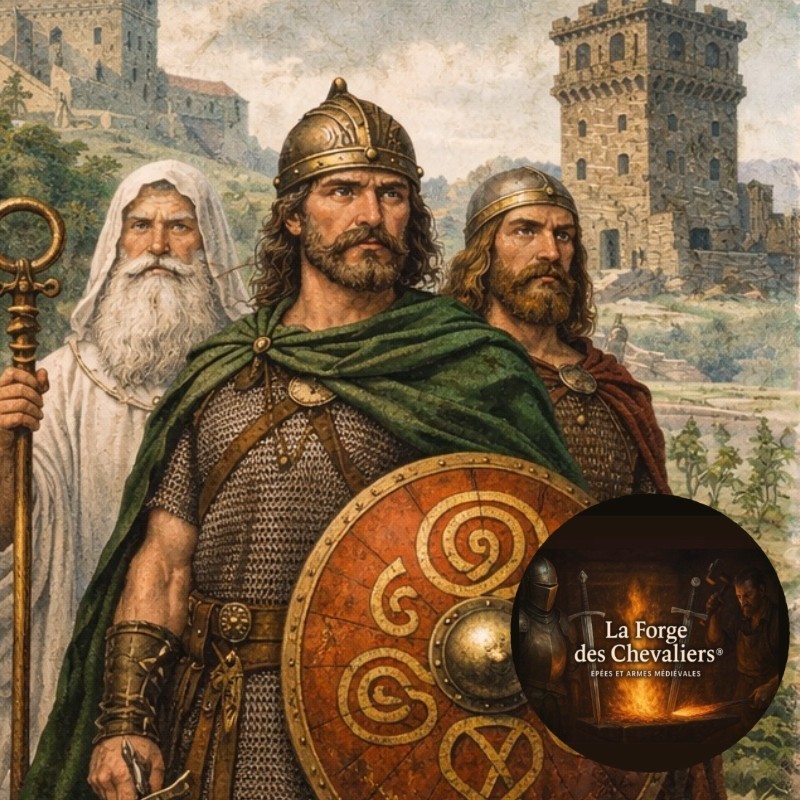








Laisser un commentaire